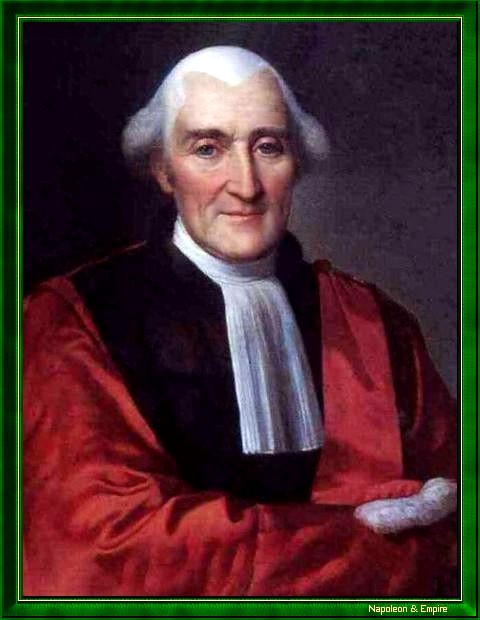DEYEUX,
Nicolas, (1745-1837)
Nicolas
Deyeux est né la 21 mars 1745 à Paris (paroisse de Saint-Louis en Isle). Il était le fils aîné de Didier Deyeux
procureur au Chatelet (décédé le 31 mars
1789) et de Marie Anne-Victoire Pia (1725?-1805), dont le père Spire Nicolas Pia (1685-1766) est apothiciare et juge consulaire à Paris (Saint Sulpice) et le frère Philippe-Nicolas Pia (1721-1799) était
apothicaire rue du Four à Paris, à proximité du carrefour de la Croix-Rouge.
Après
des études au collège Mazarin, Nicolas Deyeux devient apprenti dans l'officine de son oncle maternel.
Lors de son éloge par Etienne Pariset le premier secrétaire permanent de l'Académie de Médecine, il est dit "Deyeux était alors d'une beauté remarquable, sa taille était noble, ses membres délicats étaient moulés. La pharmacie PIA était très fréquentée : elle avait une belle et riche clientèle. De grandes dames y venaient souvent chercher elles-mêmes quelques pâtes agréables, quelques médicaments de bonbonnières, quelques vinaigres efficaces". Mais Deyeux qui était très réservé voire timide n'appréciant que peu le contact avec la clientèle. L'une d'elle conçut pour Deyeux un violent caprice, qu'elle s'ingénia à satisfaire de la façon suivante ; simulant une indisposition, elle se mit au lit et commanda chez PIA un clystère, avec recommandation expresse qu'il fût apporté par Deyeux lui-même. Celui-ci arrive, muni du précieux remède qu'il s'apprête à administrer en lieu et place, lorsque la dame lui fait comprendre par un mouvement qui détruit tout soupçon de paralysie ; qu'elle désire tout autre chose qu'un lavement médicamenteux. Deyeux s'enfuit franchissant quatre à quatre les marches de l'escalier".
Reçu
maître en pharmacie en 1772, il succédé alors à son oncle et tient son
officine avec succès pendant quinze ans. Il est appointé comme "conseiller du Roi quartinier de la ville" pour le quartier Notre Dame en 1774. Mais plus attiré par les travaux scientifiques que par
le commerce des médicaments, il vend son fond après avoir amassé une fortune en 1787 à J. P. Boudet (qui la cédera ultérieurement à son fils Felix) et
il se retire rue de Tournon à Paris où il crée son laboratoire privé. Il y a travaille notamment avec son ami Antoine Parmentier (1737-1813). Avec ce dernier il écrit entre 1787 et 1788 un remarquable mémoire sur le lait qui leur permit d'obtenir le prix de la Société Royale de médecine de Paris . En 1791 ces deux auteurs obtiennent ce prix pour leur analyse de sang de malades
Entre temps, il épouse Thérèse-Denise-Rosalie
Moreau de dix ans sa cadette (1755-1829) le 2 août 1774 à Paris, paroisse Saint Leu Saint Gilles, qui lui donne 15 ans après, le 15 juillet 1789, un fils unique prénommé
Didier-Théophile.
A partir de 1777 il devient démonstrateur en chimie au collège de Pharmacie qui vient juste d'être créé par déclaration du 25 avril 1777.
On connaît de lui des études sur l'opium, sur la noix de gale et sur l'acide gallique. On lui attribue aussi un mémoire établi en collaboration avec Herbin sur la maladie de la pierre (calculs rénaux) et la dissolution, du calcul humain dans des substances propres à l'attaquer. Il donna également un nouvelle édition annotée du "théâtre de la nature " d'Oliver de Serres.
La
Révolution faillit être fatale à Deyeux car son frère notaire à Paris prénommé
Claude-Didier, est poursuivi pour ses activités
royalistes et condamné à mort par le tribunal révolutionnaire le 19
messidor de l'an II (7 juillet 1794) et il est guillotiné deux
jours plus tard. Ce frère célibataire avait fait son testament en faveur de
Nicolas, heureusement celui-ci estimant ce testament compromettant le détruit
juste avant que des sectionnaires ne perquisitionnent chez lui.
Il ne peut échapper à leurs recherches qu'au dévouement d'un astucieux serviteur qui le cache dans une grande fontaine à eau présente dans sa cuisine.
Il continue ensuite ses travaux scientifiques et début 1795, il devient professeur à la chaire de médecine et pharmacie de l'Ecole de médecine et le 25 novembre 1797, il est élu membre de la section chimie du nouvel Institut de France.
De 1782 à 1797, il est l'un des rédacteurs du Journal des découvertes et perfectionnements de l'industrie nationale et étrangère, de l'économie rurale et domestique, de la physique, de la chimie, l'histoire naturelle, la médecine domestique et vétérinaire, enfin des sciences et des arts qui se rattachent aux besoins de la vie publié de 1782 à 1831.
Il continue à professer à l'Ecole de
Pharmacie et le 6 juillet 1802, il est nommé, par le préfet Dubois,
membre du Conseil de salubrité et d'hygiène du département de la Seine,
aux côtés de Antoine-Alexis Cadet de Vaux (1743-1828) , frère de Louis Claude.
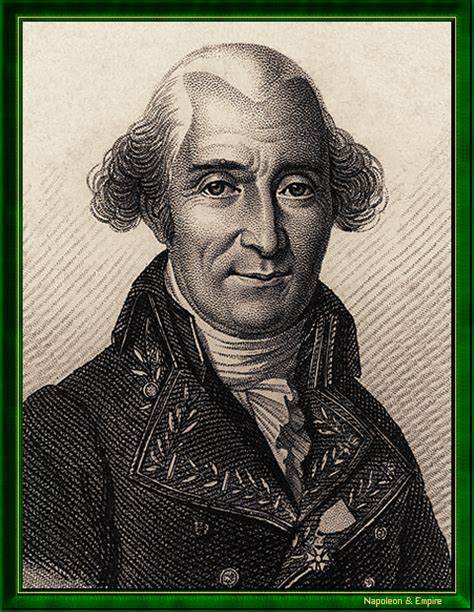 Il a accepté cet emploi avec réticences car il avait mis comme condition
formelle de n'avoir jamais à quitter Paris ni à participer à des
campagnes militaires avec la Grande Armée. Napoléon avait accédé à ces exigences, après que
l'intéressé lui eut expliqué qu'il n'avait aucune bravoure et avait une
peur panique de la mort. Deyeux n'était d'ailleurs pas un homme de
caractère, il était très indécis, irrésolu, susceptible, ne pardonnait pas la
moindre offense et n'avait que très peu d'amis.
Il a accepté cet emploi avec réticences car il avait mis comme condition
formelle de n'avoir jamais à quitter Paris ni à participer à des
campagnes militaires avec la Grande Armée. Napoléon avait accédé à ces exigences, après que
l'intéressé lui eut expliqué qu'il n'avait aucune bravoure et avait une
peur panique de la mort. Deyeux n'était d'ailleurs pas un homme de
caractère, il était très indécis, irrésolu, susceptible, ne pardonnait pas la
moindre offense et n'avait que très peu d'amis.
Il
était par contre aussi honnête qu'avare et les missions qu'il eut à
remplir mirent souvent à rude épreuve ces qualités au cours des dix ans qu'il
passa à la tête de la pharmacie de la Cour, qu'il sut
parfaitement organiser et gérer. Ce fut là une tâche aussi ingrate que difficile.
Il
était assisté par des pharmaciens ordinaires (deux en principe) et des
aides-pharmaciens. Parmi les pharmaciens ordinaires, on relève les noms bien connus de Clarion (1776-1844) botaniste et médecin, qui avait été son préparateur et
s'occupa de la pharmacie du château de Saint-Cloud, de Cadet de Gassicourt (1769-1821), de Bouillon-Lagrange, à qui succéda Rouyer (1769-1831). Ceux-ci, qui étaient tous des pharmaciens civils, à ne pas confondre
avec les pharmaciens militaires dans les armées à qui ils étaient cependant
assimilés en campagne. Ils devaient statutairement faire partie, à tour de
rôle, de la grande ambulance de campagne, accompagnant Napoléon dans tous ses
déplacements y compris lors des conflits.
C'est ainsi que Bouillon-Lagrange aurait participé aux opérations de 1805
à 1807, avant de passer au service de l'impératrice Joséphine, auprès de laquelle il resta même après son divorce. Cadet de
Gassicourt alla en Autriche en 1809 et il est probable que Rouyer
participa aux campagnes d'Espagne de 1808, de Russie de 1812 et de Saxe
de 1813. Il faut cependant reconnaître qu'on est très mal renseigné sur
le fonctionnement du service pharmaceutique de la grande ambulance,
pendant les opérations militaires.
Dans son ouvrage sur les Fournisseurs de Napoléon paru à Paris en 1893 p88, Maze-Sencier donne la liste des personnes attachées à la pharmacie impériale en 1810. Il note que Déyeux recoit 8000 francs comme premier pharmacien, Clarion résidant à Saint-Cloud 5000 francs auxquels s'ajoutait la moitié des bénéfices provenant de la vente des médicaments au public, Rouyer et Cadet comme pharmaciens-adjoints ordinaires chacun 3000 francs, Gruelle premier aide-pharmacien 1800 francs, Lecoeur deuxième aide-pharmacien 1500 francs et Boudouard garçon de laboratoire attaché à la pharmacie de Saint-Cloud 1000 francs.
Ce qui est sûr, c’est que la pharmacie sédentaire de la Cour faisait l'objet de critiques, au
point qu'au début de 1812, Napoléon, victime d'une indisposition, entra
un jour dans une violente colère et le 21 mars 1812, il ordonne de créer aux
Tuileries une vaste pharmacie d'accès commode et parfaitement
approvisionnée, ainsi que des petites annexes dans chacun des palais où
il était appelé à résider.
Jusque-là,
la fourniture des médicaments était l'affaire de l'officine de Cadet de
Gassicourt, installée rue du Coq (aujourd'hui rue Marengo) à proximité
des Tuileries. Le pharmacien ordinaire en profitait, dit-on, pour
établir des factures salées dont le règlement arrondissait notablement
ses trois mille francs annuels d'appointements comme pharmacien ordinaire. Il en résultait chaque
fois des différends avec les services du Grand-maréchal et l'Intendance
générale de la Cour.
Duroc
voulut que la pharmacie fut installée dans une dépendance du
palais, avec une salle d'opérations attenant ainsi qu'un dépositoire où
seraient éventuellement transportés les corps des personnes venant à
décéder aux Tuileries, de façon à soustraire à la vue des souverains le
triste spectacle des convois et autres cérémonies funèbres.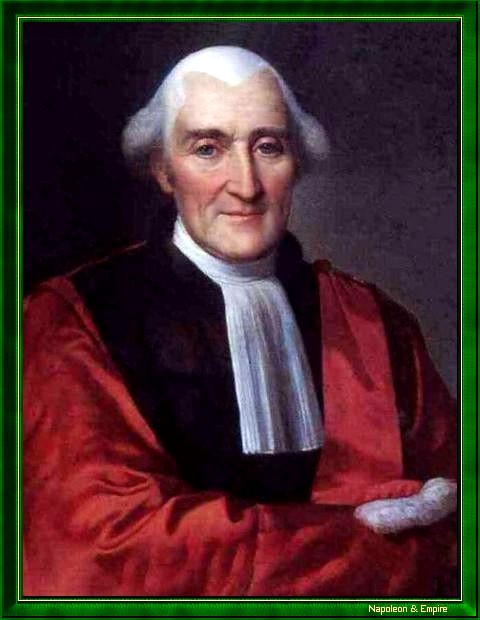
Premier Pharmacien
n'était pas un travail bien passionnant pour un savant comme Deyeux,
qui fut aussi invité assez sèchement à faire personnellement, une
enquête au sujet de caisses de médicaments destinés à l'Espagne, qui
avaient été égarées ou détournées. Ce fut à cette époque que ces
travaux administratifs l'ayant aigri, il se brouilla complètement avec
son adjoint Cadet de Gassicourt qu'il accusait, non sans raison, de
forcer sur les prix de ses fournitures.
Heureusement,
il reçut alors de Corvisart la délicate mission
pseudo-pharmaceutique de confectionner lui-même, car c'était là un secret
d'Etat, des pilules à base de mica panis (mie de pain) destinées à soigner les maux imaginaires de l'Impératrice.
Devenu septuagénaire, durant les Cent-Jours et le retour de Napoléon, Deyeux ne reprend pas son service comme Premier Pharmacien pas plus que Jacques Clarion et c'est Cadet de Gassicourt qui assume la direction du service sans être jamais nommé
officiellement Premier pharmacien. Rouyer alla
remplacer Clarion à Saint-Cloud et deux nouveaux pharmaciens ordinaires sont
préposés aux ambulances de campagne, Fourey et Morin.
Deyeux reçoit en 1819, sous la Restauration et non sous l'Empire, la croix de chevalier de la Légion
d'honneur. Il continue son professorat sous la Restauration et il est nommé en
1816 membre de l'Académie de médecine.
Il est destitué de sa chaire le
18 novembre 1822 à la suite d'un chahut d'étudiants lors de la séance inaugurale de l'année académique (15 novembre 1822) contre son recteur de l'académie de Paris l'abbé Dominique-Charles Nicolle (1758-1835) et la main mise des religieux et royale mis en place par Louis XVIII. Cela conduit par le ministre de l'intérieur Corbière à la suppression de la faculté de Paris et de onze professeurs dont Deyeux. Ceci provoqua de graves difficultés pour les étudiants en médecine en cours de cursus qui durent l'arrêter. Mais Louis-Philippe le
réintègre dans le corps professoral comme les onze autres professeurs le 5 octobre 1830, mais vu son grand âge il ne reprend pas cette activité.
Il vit encore sept ans et meurt à Passy,
le 25 avril 1837, à l'âge de quatre-vingt douze ans. Il est enterré au cimetière Montparnasse.
Son
fils unique Didier-Théophile fut sous l'Empire,
auditeur au conseil d'Etat. Il épouse une cousine maternelle, Victorine-Emilie Moreau. Il meurt au 7 de la rue Garancière, le 12 mai
1849 en laissant deux enfants.
Bibliographie des articles et rapports de Deyrieux selon Jaime Wisniak
Achard, C. F., Chaptal, J. A. & Deyeux, N. (1811). Instruction sur la Culture et la Récolte des Betteraves, sur la Manière d'en Extraire Économiquement le Sucre et le Sirop. Paris.
Berthollet, C. L., Vauquelin, L. N. & Deyeux, N. (1810). Rapport fait à l’Institut sur un Mémoire de M. Tarry, sur la Composition des Encres à Écrire. Ann. Chim., 75, 194-203.
Boudet, F. (1837). Notice Historique sur M. Deyeux. J. Pharm., 23, 484-487.
Chaptal, J. A. & Deyeux, N. (1800). Rapport fait a la Class des Sciences de Mathématiques et Physiques de l’Institut National par la Commission Chargée de Répéter les Expériences de
Deyeux, N. (1793). Mémoire sur la Noix de Galle, Contenant son Analyse, celle de l’Acide
Gallique, et un Examen Particulier du Précipité Opéré pas ces Deux Substances lorsqu’on les Mêlé avec le Sulfate de Fer. Ann. Chim., 17, 3-66; J. Phys., 42, 401-428.
Deyeux, N. (1793). Examen Comparatif du Lait de Deux Vaches Nourries Successivement avec le
Fourrage Ordinaire et celui de Mais ou Blé de Turquie. Ann. Chim., 17, 320-332.
Deyeux, N. (1797). Sur l’Éther Nitreux. Ann. Chim., 22, 144-157.
Deyeux, N. (1798). Mémoire sur les Filets ou Poils qui Recouvrent toute la Plant qui Produit le
Cicer Arietinum (Pois chiche), et Examen Chimique de la Liqueur que ses Poils Laissent
Exsuder. J. Phys., 46, 362-369.
Deyeux, N. (1799). Sur les Emplâtres et leur Préparation. Ann. Chim., 33, 50-66.
Deyeux, N. (1803). Recherches Médico-Chimiques sur les Vertus et les Principes des Cantharides. Ann. Chim., 48, 29-42.
Deyeux, N. (1805). Nouvel Appareil pour Faire le Gaz Oxide de Carbone. Ann. Chim., 53, 76-82.
Deyeux, N. (1806a). Mémoire sur la Sève des Plantes et Principalement sur Celle de la Vigne et du Charme, avec une Analyse de ce Fluide. Mém. Savans Etrangères, 1, 83-100 (read in 1797).
Deyeux, N. (1806b). Mémoire sur le Sang Bilieux Considéré sous les Rapports Chimiques. Mém. Savans Etrangères, 1, 136-148 (Read 1797).
Deyeux, N. (1806c). On Waters Distilled from Inodorous Plants. Phil. Mag., 25, 3-8.
Deyeux, N. (1808). Analyse des Nouvelles Eaux Minérales de Passy. Méquignon, Paris.
Deyeux, N. (1811). Mémoire sur l’Extraction du Sucre de Betterave, Présenté a la Première Classes de l’Institut National le 19 Novembre 1810. Ann. Chim. [1], 57, 42-62.
Deyeux, N. (1815). Note sur l’Acide Pyroligneux ou Acide Acétique. Ann. Chim., 93, 321-332.
Deyeux, N., Chaptal, Cels, D’Arcet, Fourcroy, Guiton, Parmentier, Tessier, & Vauquelin. (1800). Rapport fait à la Classe de Sciences Mathématiques et Physiques de l’Institut National dans sa Séance du Messidor an 8. J. Phys., 51, 371-389.
Parmentier, A. A. & Deyeux, N. (1790a). Mémoire qui a Remporté le Premier Prix, le 23 Février
1790, sur la Question Suivante, Proposée par la Société Royale de Médecine: Déterminer, par l'Examen Comparé des Propriétés Physiques et Chimiques, la Nature des Laits de Femme, de Vache, de Chèvre, d'Ânesse, de Brebis et de Jument, 111 pages. Hist. Soc. Roy.
Méd., 9.
Parmentier, A. A. & Deyeux, N. (1790b). Sur Analyse du Lait. Ann. Chim., 6, 183-196.
Parmentier, A. A. & Deyeux, N. (1794). Mémoire sur le Sang, dans Lequel on Répond à Cette Question: Déterminer, d'Après des Découvertes Modernes Chimiques et par des Expériences Exactes, quelle est la Nature des Altérations que le Sang Éprouve dans les Maladies Inflammatoires, dans les Maladies
Fébriles, Putrides et le Scorbut. Imprimerie de Boiste, Paris, 1791, 56 pages. J. Phys., 44, 372- 390, 435-473.
Parmentier, A. A. (1799). Deyeux, N., Précis d’Expériences et Observations sur les Différentes Espèces de Lait, Considérées dans leurs Rapports avec la Chimie, la Médecine, et l’Economie Rurale. Barrois, Paris.
Références bibliographiques
Ramé Henri. Revue du Souvenir Napoléonien. 1988, 360.
Riaud Xavier. Pharmaciens du Premier Empire. Revue Histoire de la pharmacie.. 2017, 104eme année N°396, 609-619.
Devaux Paul. Les grands pharmaciens. Les pharmaciens de Napoléon. Bulletin de la Société d'histoire de la pharmacie.1921.9ème année. n°30. 317-333.
Wisniak Jaime. Nicolas Deyeux. Rev. CENIC. Biol. 2020. 51, (1) 69-74.
Ségal Alain. Une curieuse attestation évoquant la suppression de la Faculté de médecine de Paris le 21 novembre 1822. Histoire des sciences médicales. 2009, XLIII N°2, 189-194
Accueil
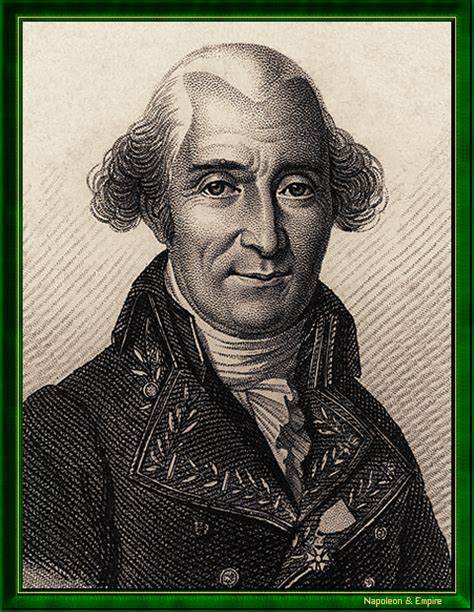 Il a accepté cet emploi avec réticences car il avait mis comme condition
formelle de n'avoir jamais à quitter Paris ni à participer à des
campagnes militaires avec la Grande Armée. Napoléon avait accédé à ces exigences, après que
l'intéressé lui eut expliqué qu'il n'avait aucune bravoure et avait une
peur panique de la mort. Deyeux n'était d'ailleurs pas un homme de
caractère, il était très indécis, irrésolu, susceptible, ne pardonnait pas la
moindre offense et n'avait que très peu d'amis.
Il a accepté cet emploi avec réticences car il avait mis comme condition
formelle de n'avoir jamais à quitter Paris ni à participer à des
campagnes militaires avec la Grande Armée. Napoléon avait accédé à ces exigences, après que
l'intéressé lui eut expliqué qu'il n'avait aucune bravoure et avait une
peur panique de la mort. Deyeux n'était d'ailleurs pas un homme de
caractère, il était très indécis, irrésolu, susceptible, ne pardonnait pas la
moindre offense et n'avait que très peu d'amis.